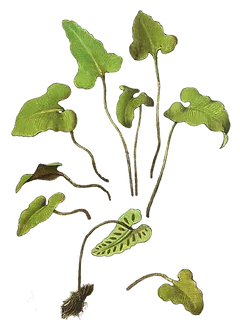Mickael Sandel / Harvard University
La dimension morale du meurtre
"Certaines personnes croient que la philosophie habite les sphères célestes. Ma Conviction est qu'elle est chez elle dans la cité. C'est pour cela qu'elle doit être présentée de manière claire, mais aussi captivante. On doit pouvoir éprouver les questions qu'elle nous pose. Socrate concevait la philosophie de cette manière. Il marchait dans les rues d'Athènes et interrogeait ou de l'énonciation de principes immuables."
Michael Sandel
Pour la troisième des semaines dédiées à vos créations, nous vous proposons de vous inspirer du philosophie politique de Michael Sandel, professeur de l’université de Harvard, de ses réflexions et démonstrations autour de la notion de justice et de l’utilité des principes moraux.
Vous trouverez ci-dessous un lien pour suivre le premier cours de la série “Qu’est-il juste de faire” de Michael Sandel (en anglais), intitulé : la Dimension morale du meurtre ( c’est l’un des plus célèbres cours de philosophie en ligne - il a été vu 15 millions de fois depuis sa mise en ligne ).
Vous trouverez ensuite une traduction en français du chapitre du livre dans lequel il reprend les contenus de ce cours et quelques liens en référence aux histoires vraies citées par M. Sandel
Ce que vous devrez faire cette semaine :
constituer un groupe de travail ;
prendre le temps de découvrir ce cours ;
débattre entre vous des questions que soulèvent les cas hypothétiques ou réels que ce cours présente ;
créer une œuvre susceptible de poser à son tour les questions morales et philosophiques que ce cours soulève ou des questions du même type.
Comme lors des semaines de créations précédentes, vous pouvez utiliser tous les médiums artistiques qu’il vous plaira, mais obligatoirement de façon collective.
Bon travail.
Cours filmé
Les contenus (en français) :
I . Le tramway fou
a. Les deux voies
Imaginez-vous en train de conduire un tramway dévalant à 100 km/heure. Vous apercevez face à vous sur les rails cinq cheminots, les outils à la main. Vous essayez d’arrêter le tramway, mais vous n’y parvenez pas. Les freins ne répondent pas. Vous êtes désespéré, parce que vous savez que si vous fauchez ces cinq ouvriers, ils mourront tous. (Admettons que vous en soyez certain.)
Soudain, vous remarquez la présence d’une voie sur la droite. Sur cette voie aussi il y a des travaux, mais un seul ouvrier s’y attèle. Vous vous rendez compte que vous pouvez engager le tramway sur cette voie de côté, tuant l’ouvrier isolé, mais épargnant les cinq autres.
Que devez-vous faire ?
La plupart des gens vont dire :
« Prenez la voie de côté ! Il est tragique de tuer une personne innocente, mais il l’est plus encore d’en tuer cinq. »
Il est préférable de sacrifier une vie pour en sauver cinq.
b. Une autre version de l’histoire
Envisageons maintenant une autre version de l’histoire du tramway. Cette fois, vous n’êtes pas le conducteur, mais un simple témoin sur un pont qui passe au-dessus de la voie. Cette fois, il n’y a pas de voie de côté. Un tramway arrive à vive allure, et, au bout du rail, cinq ouvriers à pied d’œuvre. Là encore, les freins sont défaillants. Le tramway est sur le point de heurter les cinq ouvriers. Vous vous sentez impuissant face au désastre qui approche, jusqu’à ce que vous remarquiez, se tenant à vos côtés sur le pont, un homme très corpulent. Vous pourriez le pousser par-dessus la rambarde, sur la voie, pour barrer la route au tramway. Il mourrait, mais les cinq ouvriers seraient sauvés. (Vous envisagez de sauter vous-même sur la voie, mais vous estimez que vous n’êtes pas de taille à bloquer le tramway.)
Serait-il juste de pousser cet homme corpulent sur la voie ?
La plupart des gens vont dire :
« Bien sûr que non. Ce serait complètement immoral de pousser ce pauvre homme sur la voie. »
Pousser un homme vers une mort certaine est définitivement insupportable, même si cela permet de sauver la vie de cinq autres innocents.
D’un point de vue moral toutefois, ce raisonnement est assez énigmatique : pour quelle raison le principe qui semble juste dans le premier cas – sacrifier une vie pour en sauver cinq – paraît-il injuste dans le second ?
Si, comme le suggère notre réaction dans le premier cas, c’est le nombre qui importe, c’est-à-dire s’il est préférable de sauver cinq vies plutôt qu’une seule, alors pourquoi ne devrions-nous pas appliquer ce principe dans le second cas et pousser l’homme sur les rails du tramway ?
Il semble vraiment cruel de pousser un homme vers sa mort, même pour une bonne cause. Mais est-il moins cruel de tuer un homme en détournant un tramway sur la voie où il se trouve ?
Peut-être est-ce mal de pousser l’homme du pont parce qu’on l’utilise contre son gré. Après tout, il n’a pas choisi d’être impliqué. Il se tenait tout simplement là. Mais nous pourrions en dire autant de la personne isolée qui travaille sur la voie. Elle n’a pas davantage choisi d’être impliquée. Elle n’a pas décidé de donner sa vie en sacrifice dans l’éventualité où un tramway fou passerait par là ; elle fait seulement son travail.
On pourrait alors considérer que, contrairement aux passants alentours, les cheminots s’exposent consciemment à ce type de risque. Mais on peut supposer aussi que le fait d’accepter de mourir dans une situation d’urgence pour sauver d’autres personnes ne fait pas partie du travail et que l’ouvrier isolé n’a pas plus consenti à sacrifier sa vie que le témoin se tenant sur le pont.
Peut-être que la différence morale ne dépend pas de l’effet produit sur les victimes – les deux meurent – mais de l’intention poursuivie par la personne qui prend la décision.
En tant que conducteur, vous pourriez défendre votre décision de dévier le tramway en faisant valoir que vous n’aviez pas l’intention de causer la mort de l’ouvrier isolé – si prévisible fût-elle ; vous auriez atteint votre objectif, même si, par un heureux coup du destin, vous aviez réussi à sauver les cinq ouvriers et que le sixième eût également réussi à s’en sortir indemne.
Mais cela vaut également dans le cas où vous poussez l’individu sur la voie. Sa mort n’est pas votre objectif. Tout ce qui importe, c’est qu’il bloque le tramway. S’il y parvient tout en survivant, vous en serez ravi.
À moins que, tout bien réfléchi, les deux cas doivent être envisagés en fonction du même principe. Il s’agit, chaque fois, d’un choix délibéré de causer la mort d’une personne innocente afin de prévenir la perte d’un plus grand nombre de vies humaines. Il est possible que votre réticence à pousser l’homme sur la voie n’exprime qu’un malaise passager, une hésitation que vous devez surmonter. Il est vrai qu’il semble plus cruel de pousser, de ses propres mains, un homme vers la mort, que de manœuvrer le volant d’un tramway. Mais une bonne décision n’est pas toujours facile à prendre. Voyons jusqu’où tient cette idée en modifiant légèrement le récit.
c. Mécanisation du meurtre
Supposez qu’il vous soit possible de provoquer la chute de l’homme sur la voie sans avoir à le pousser ; imaginez qu’il se tienne sur une trappe que vous pourriez ouvrir en actionnant un levier. Il n’est plus question de pousser quiconque, mais vous obtenez le même résultat. Est-ce juste pour autant ? Ou est-ce toujours pire pour vous, d’un point de vue moral, que de dévier, en tant que conducteur, le tramway ?
Il n’est pas facile d’expliquer la différence morale entre ces deux cas : pourquoi dévier le tramway semble-t-il juste, alors que pousser un homme sur la voie paraît injuste ?
Mais voyez le besoin que nous éprouvons d’établir par notre raison une distinction convaincante entre les deux – et, si nous n’y réussissons pas, de réévaluer notre jugement jusqu’à ce que nous sachions déterminer ce qu’il convient de faire dans les deux cas.
Nous concevons parfois le raisonnement moral comme une manière de convaincre d’autres personnes. Mais il s’agit aussi d’une façon de faire la part des choses entre nos différentes convictions morales, de déterminer ce que nous croyons et pourquoi.
Certains dilemmes moraux surgissent quand des principes moraux entrent en conflit. Par exemple, l’un des principes en jeu dans l’histoire du tramway prescrit de sauver autant de vies qu’il est en notre pouvoir de le faire. Mais cela va à l’encontre de cet autre principe stipulant qu’il est injuste de tuer une personne innocente, même pour une bonne cause. Confrontés à une situation où sauver plusieurs vies suppose de tuer un innocent, nous nous retrouvons moralement très embarrassés. Nous devons essayer de déterminer lequel de ces deux principes importe le plus ou est le plus approprié au vu des circonstances.
D’autres dilemmes moraux apparaissent parce que nous ne sommes pas certains de ce que sera le cours des événements. Les exemples hypothétiques, comme l’histoire du tramway, suppriment l’incertitude qui pèse toujours sur nos choix dans la vraie vie. Ils supposent que nous savons avec certitude combien de personnes mourront si nous ne dévions pas la course folle du tramway ou si nous choisissons de ne pas pousser l’homme par-dessus le pont. Il en résulte que ce type d’histoires constituent des guides très imparfaits pour l’action, mais qu’elles offrent en revanche des outils d’analyse morale très utiles.
En mettant de côté ce qui relève des contingences – « qu’en est-il si les ouvriers aperçoivent le tramway et s’écartent à temps ? » –, les exemples hypothétiques nous aident à isoler les principes moraux en jeu et à examiner la force que nous attachons à chacun d’eux.
II . Les éleveurs de chèvres afghans
a.
Prenons maintenant un dilemme moral réel, similaire à certains égards à la fable fantaisiste du tramway fou, mais compliqué par l’incertitude qui plane sur la manière dont les choses se passeront.
En juin 2005, une équipe des forces spéciales composée du quartier-maître Marcus Luttrell et de trois autres SEALs de l’US Navy entreprit une mission secrète de reconnaissance en Afghanistan, aux abords de la frontière pakistanaise. Ils avaient pour objectif de localiser un haut dirigeant taliban, proche d’Oussama ben Laden.
Selon les rapports fournis par les services secrets, leur cible, qui était à la tête d’un groupe de 140 à 150 combattants lourdement armés, s’était réfugiée dans un village d’une région reculée et montagneuse de l’est d’Asadabad, dans la province de Kunar. L’équipe prit position sur une crête surplombant le village. C’est alors qu’elle se retrouva face à deux éleveurs afghans menant une centaine de chèvres. Les chevriers étaient accompagnés d’un garçon de quatorze ans. Aucun n’était armé. Les soldats américains pointèrent sur eux leurs fusils, les firent asseoir sur le sol, et se mirent à délibérer sur leur sort.
D’un côté, les éleveurs de chèvres avaient tout l’air de paisibles civils. De l’autre, les laisser filer exposait les soldats américains au risque qu’ils informent les Talibans de leur présence. Alors qu’ils examinaient les différentes options qui s’offraient à eux, les quatre SEALs s’aperçurent qu’ils n’avaient pas de corde, qu’ils ne pouvaient donc pas attacher les Afghans et se donner ainsi le temps de trouver une autre cachette. Il fallait les tuer ou les laisser partir.
Un des camarades de Luttrell fit valoir la nécessité de tuer les éleveurs de chèvres :
« Nous sommes en mission, derrière les lignes ennemies, envoyés ici par nos autorités. Nous avons le droit de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver nos propres vies. La décision militaire est évidente. Les laisser partir serait une erreur. »
Luttrell était partagé :
« En mon âme et conscience, je savais qu’il avait raison », écrivit-il plus tard. « Nous ne pouvions vraiment pas les laisser partir. Le problème, c’est qu’en moi s’est fait entendre une autre voix, une voix chrétienne, qui se faisait alors pressante. Elle ne cessait de murmurer en moi que c’était mal d’exécuter de sang-froid ces hommes sans armes. »
Luttrell n’expliqua pas ce qu’était cette « voix chrétienne », mais reste que, en dernier ressort, il ne put se résoudre à tuer les éleveurs de chèvres. Son vote fit pencher la balance en faveur de la libération des Afghans, un de ses camarades ayant choisi de s’abstenir. Plus tard, il regretta ce vote.
Environ une heure et demie après qu’ils eurent laissé partir les éleveurs de chèvres, les quatre soldats se retrouvèrent encerclés par 80 à 100 combattants talibans, armés de AK-47 et de lance-grenades. Dans le féroce combat qui s’ensuivit, les trois camarades de Luttrell trouvèrent la mort. Les Talibans abattirent un hélicoptère américain, avec 16 hommes à bord qui cherchaient à secourir l’unité de SEALs. Aucun d’entre eux ne survécut. Luttrell, sévèrement blessé, parvint à survivre en se laissant glisser sur un versant de la montagne et en rampant sur près de dix kilomètres, jusqu’à un village pachtoune, où il fut protégé des Talibans jusqu’à l’arrivée des secours.
Rétrospectivement, Luttrell condamna son vote en faveur de la libération des éleveurs de chèvres :
« C’était la décision la plus stupide, la plus imbécile, la plus crétine que j’aie jamais prise de ma vie », écrivit-il dans un livre où il raconte cette épreuve. « Je devais avoir perdu la tête. Je savais que mon vote pouvait signer notre arrêt de mort à tous […]. Du moins, c’est ainsi que je vois les choses aujourd’hui […]. Mon vote a été décisif, et il me hantera jusqu’à la tombe où l’on m’ensevelira quelque part à l’est du Texas. »
Si le dilemme auquel se sont trouvés confrontés ces soldats était si difficile à surmonter, c’est en partie en raison de l’incertitude qui planait sur les conséquences de la libération des Afghans. Ceux-ci poursuivraient-ils simplement leur chemin ou alerteraient-ils les Talibans ?
b.
Mais admettons que Luttrell ait su que la libération des éleveurs de chèvres conduirait à cette bataille dévastatrice, causant la mort de ses camarades, dix-neuf morts américains, sa blessure et l’échec de sa mission, sa décision s’en serait-elle trouvée modifiée ?
Pour Luttrell, aujourd’hui, la réponse est claire et nette : il aurait dû tuer les éleveurs de chèvres. Considérant le désastre qui résulta de la décision prise, il est difficile de lui donner tort.
Si l’on ne tient compte que du calcul, la décision dont Luttrell défend désormais le principe est similaire à celle qui s’impose dans l’histoire du tramway. Tuer les trois Afghans aurait épargné la vie de ses trois camarades et des seize soldats américains qui essayèrent de les secourir.
Mais à quelle version de l’histoire du tramway la situation ressemble-t-elle le plus ? Tuer les éleveurs correspond-il plutôt au fait de manœuvrer le volant du tramway ou de pousser un homme par-dessus le pont ?
Que Luttrell ait anticipé le danger, mais n’ait pu néanmoins se résoudre à tuer de sang-froid des civils sans armes suggère que nous pourrions être plus proches du second cas que du premier. Et pourtant, il semble en quelque sorte que la décision de tuer les éleveurs de chèvres s’impose plus fortement que celle de pousser l’homme du pont. Cette impression est peut-être justifiée par le soupçon – confirmé par la suite – que ces Afghans n’étaient pas des passants innocents, mais des sympathisants des Talibans. Voyez cette analogie : si l’on avait eu des raisons de croire que l’homme sur le pont avait saboté les freins du tramway dans l’espoir de tuer les ouvriers sur la voie (mettons qu’ils soient ses ennemis), l’argument moral nous incitant à le pousser du pont gagnerait en puissance. Resterait encore à savoir qui étaient ses ennemis et pourquoi il voulait leur mort. Mais si nous apprenions que les ouvriers sur la voie étaient des membres de la Résistance et que l’homme corpulent sur le pont était un nazi cherchant à les éliminer en sabotant le tramway, la décision de le pousser pour les sauver s’imposerait moralement.
Il est, bien sûr, tout à fait possible que les éleveurs de chèvres afghans n’aient pas été des sympathisants des Talibans, mais des personnes voulant se tenir en dehors du conflit, voire des opposants contraints de révéler la présence des soldats américains.
c.
Supposez que Luttrell et ses camarades aient su avec certitude que les éleveurs ne leur voulaient aucun mal, mais seraient torturés par les Talibans pour qu’ils dévoilent leur position. Les Américains auraient pu vouloir tuer les éleveurs pour sauver leur mission et leur propre vie, mais la décision aurait été plus déchirante (et moralement plus contestable) que s’ils avaient eu la certitude que les éleveurs de chèvres étaient des espions pro-talibans.
Dailymotion : "Du sang et des larmes"
Wiki : Marcus_Luttrell
III . Dilemmes moraux
Peu d’entre nous se trouvent confrontés à des choix aussi fatidiques que celui auquel ont dû faire face les soldats dans ce village de montagne ou le témoin de la course folle du tramway. Mais de tels dilemmes nous éclairent cependant sur la manière dont opère un argument moral, dans nos vies personnelles comme dans l’espace public.
La vie, dans les sociétés démocratiques, est traversée de désaccords sur le bien et le mal, le juste et l’injuste. Certains sont en faveur du droit à l’avortement, d’autres y voient la légitimation d’un meurtre. Certains estiment qu’il est équitable de taxer les riches pour secourir les pauvres, d’autres trouvent injuste au contraire d’imposer des revenus que les gens ont acquis à force d’efforts. Certains défendent le principe de la discrimination positive dans l’accès aux établissements d’enseignement supérieur pratiquant la sélection pour corriger des injustices commises dans le passé, d’autres considèrent que c’est là une forme de discrimination inversée infligée à ceux qui, sur la base de leur seul mérite, pourraient être admis dans ces grandes écoles. Certains voient en la torture de personnes soupçonnées de terrorisme une abomination morale indigne d’une société libre, quand d’autres la défendent si, en dernier ressort, elle peut permettre de prévenir une attaque terroriste.
Ces désaccords peuvent faire basculer une élection, déclencher des guerres dites « culturelles ». Vu la passion et l’intensité qui animent ces débats moraux, on pourrait croire que nos convictions morales sont déterminées une fois pour toutes, par notre éducation ou notre foi, et qu’elles se tiennent hors de portée de la raison. Si cela est vrai, alors l’idée de persuasion morale n’aurait aucun sens, et ce que nous pensons être des débats publics sur la justice et les droits ne seraient rien d’autre qu’une volée d’affirmations dogmatiques, une simple bataille de tartes à la crème idéologique. Dans ses plus mauvais jours, la vie politique y ressemble à s’y méprendre. Mais cela n’a rien d’inéluctable.
Il arrive qu’un argument nous fasse changer d’avis. Comment dès lors se frayer un chemin sur le terrain très disputé de la justice et de l’injustice, de l’égalité et de l’inégalité, des droits individuels et du bien commun ?
On peut commencer par remarquer que la réflexion morale se déploie naturellement lorsqu’on est confronté à une question morale délicate. Nous partons d’une opinion ou d’une conviction quant à ce qu’il convient de faire : « Dévier le tramway vers la voie latérale ». Puis nous réfléchissons à ce qui justifie notre conviction et cherchons à identifier le principe sur lequel elle est fondée :
« Il est préférable de sacrifier une vie si cela doit permettre d’en sauver plusieurs. »
Mais confrontés à une situation qui remet en question ce principe, nous sommes profondément troublés :
« Je pensais qu’il était toujours juste de sauver autant de vies que possible, et il semble pourtant injuste de pousser cet homme d’un pont (ou de tuer des éleveurs de chèvres désarmés). »
Ressentir la force de ce trouble et le désir de le dissiper est le ressort même de la philosophie.
Sous l’effet de cette tension, nous pouvons soit réviser notre jugement sur la bonne décision à prendre, soit repenser le principe sur lequel nous nous sommes tout d’abord appuyés.
À la faveur des expériences nouvelles qu’il nous est donné de vivre, nous interrogeons nos jugements et nos principes, passant des uns aux autres, révisant chacun à la lumière de l’autre, et inversement.
Ce mouvement de l’esprit, du monde de l’action vers le domaine des raisons et des raisons vers l’action, est précisément ce en quoi consiste la réflexion morale.
Même si nous réussissons, au cours de notre vie, à accorder nos intuitions morales et les principes sur lesquels nous fondons nos engagements, qu’est-ce qui nous garantit qu’il ne s’agit pas simplement d’un assemblage cohérent de préjugés ?
Pour répondre à cette question, il faut garder à l’esprit que la réflexion morale n’est pas une quête solitaire, mais qu’elle s’inscrit toujours dans une démarche publique. Elle requiert un interlocuteur – un ami, un voisin, un camarade, un concitoyen.
IV . Manger le mousse de la Mignonnette
Au cœur de l’été 1884, quatre marins anglais se retrouvèrent dans un canot de sauvetage perdu en pleine mer, dans le sud de l’Océan Atlantique à plus de 1 600 kilomètres de la côte. Leur yacht, La Mignonette, avait coulé dans une tempête, et ils n’avaient dû leur survie qu’à ce canot où ils avaient trouvé refuge, sans eau potable, avec pour seuls vivres deux boîtes de navets en conserve.
Le capitaine, Tom Dudley, le second, Edwin Stephens, et le marin Edmund Brooks « étaient tous des hommes respectables », rapportent des journaux de l’époque. Le quatrième membre de l’équipage, le mousse Richard Parker, était un orphelin de dix-sept ans. C’était là son premier voyage au long cours. Contre l’avis de ses amis, il s’était enrôlé, plein de cet « espoir propre à l’ambition de la jeunesse », convaincu que ce voyage ferait de lui un homme. Malheureusement, il n’en fut rien.
À bord de leur canot, les quatre naufragés scrutaient l’horizon, espérant y voir se détacher un navire qui puisse les secourir. Les trois premiers jours, ils se partagèrent de petites rations de navets. Le quatrième, ils attrapèrent une tortue. Pendant quelques jours, ils subsistèrent en se nourrissant de la tortue et du reste des navets. Puis ils n’eurent plus rien à manger durant huit jours.
Passant outre les recommandations de ses compagnons d’infortune, Parker, le mousse, avait bu de l’eau de mer. Depuis lors, il était souffrant, allongé dans un coin du canot. Il semblait mourant. Au dix-neuvième jour de leur calvaire, Dudley, le capitaine, suggéra de tirer au sort celui qui mourrait pour que les autres puissent survivre. Brooks refusa et l’idée d’un tel tirage au sort fut écartée.
Le lendemain, il n’y avait toujours pas le moindre navire à l’horizon. Dudley invita Brooks à détourner son regard et fit comprendre à Stephens qu’il devait être mis fin aux jours de Parker. Dudley prononça une prière et plongea un canif dans la veine jugulaire du jeune homme. Brooks oublia ses scrupules moraux pour prendre part au festin macabre. Durant quatre jours, les trois hommes se nourrirent de la chair et du sang du jeune mousse.
C’est alors qu’un navire vint à leur rescousse. Dudley note dans son journal, avec un cynisme ahurissant : « le vingt-quatrième jour, alors que nous étions en train de prendre notre petit-déjeuner », un navire apparut enfin.
On fit monter à bord les trois survivants qui, à leur retour en Angleterre, furent arrêtés et traduits en justice. Brooks devint témoin à charge dans le procès de Dudley et de Stephens. Ces derniers confessèrent librement qu’ils avaient assassiné et mangé Parker ; selon eux, ils n’avaient pas eu le choix.
Supposez que vous soyez le juge dans cette affaire. Quelle décision prendriez-vous ? Pour simplifier, écartez la question du droit et partez du principe que l’on vous demande si, dans un tel cas, il est moralement permis de tuer le mousse.
Pour la défense, l’argument le plus fort tient en ceci que, considérant le caractère désespéré de la situation, pour sauver trois personnes, il était nécessaire d’en tuer une. S’ils n’avaient pas tué et mangé l’un d’eux, les quatre hommes seraient probablement morts. Parker malade et affaibli n’aurait pas survécu de toute façon ; il était donc logique que ce fût lui. D’autant que, contrairement à Dudley et à Stephens, il n’avait personne à charge. Sa mort n’a privé personne de soutien et n’a endeuillé ni femme ni enfants.
Cet argument s’expose à au moins deux objections.
Tout d’abord, on peut se demander si, tout bien considéré, les avantages résultant de la mort du mousse excèdent réellement ses coûts. Même en prenant en compte le nombre de vies sauvées, le bonheur des survivants et celui de leurs familles, il reste que la légitimation d’un tel crime pourrait avoir des conséquences néfastes pour la société dans son ensemble – en affaiblissant l’interdit du meurtre, par exemple, ou en encourageant la tendance des gens à se faire justice eux-mêmes, ou bien encore en compliquant sérieusement, pour les capitaines, le recrutement de jeunes mousses.
Ensuite, quand bien même les avantages seraient effectivement, tout bien considéré, plus importants que les coûts, ne restons-nous pas, pour des raisons qui portent bien au-delà de tout calcul coût-avantage, tenaillés par le sentiment qu’il est mal de tuer et de manger un mousse sans défense ? Quel que soit l’avantage que certains puissent y trouver, n’est-il pas immoral d’user ainsi d’un être humain – en mettant fin à ses jours sans son consentement, en profitant de sa vulnérabilité ?
Quiconque est horrifié par les actions de Dudley et de Stephens trouvera très insuffisante la première objection. Celle-ci reprend en effet à son compte ce présupposé utilitariste qui veut que la moralité passe par la mesure des coûts et des avantages, et exige simplement une estimation plus étendue des conséquences sociales.
Pour ceux que l’assassinat du mousse indigne moralement, la seconde objection touche plus juste. Bien juger en la matière ne consiste pas simplement à se contenter d’un calcul sur des conséquences à répartir entre coûts ou avantages.
La moralité signifie quelque chose de plus – quelque chose qui s’attache au comportement que les êtres humains doivent avoir les uns envers les autres. Ces deux façons d’envisager le cas du canot de survie illustrent des conceptions concurrentes de la justice.
Selon la première approche, la moralité d’une action dépend essentiellement des conséquences qu’elle entraîne ; il faut faire tout ce qui, tout bien considéré, peut produire la situation la plus avantageuse.
Selon la seconde, nous ne devrions pas, d’un point de vue moral, nous préoccuper uniquement des conséquences de nos actions ; il est des devoirs et des droits qui commandent le respect, pour des raisons indifférentes aux conséquences sociales.
Pour résoudre le problème que pose ce cas, ainsi que bon nombre de dilemmes moins extrêmes auxquels nous pouvons être communément confrontés, il faut explorer quelques grandes questions de philosophie morale et politique : la moralité est-elle affaire de calcul, qu’il s’agisse de vies humaines, de coûts ou d’avantages, ou bien faut-il considérer que certains devoirs moraux et droits humains sont à ce point fondamentaux qu’ils s’élèvent bien au-delà de tout calcul de cet ordre ?
Et si des droits sont bien fondamentaux en ce sens – qu’ils soient dits naturels, sacrés, inaliénables ou catégoriques –, comment parvenir à les identifier ? Et qu’est-ce qui les rend fondamentaux ?